Au Kirghizistan, dès que vous annoncez que vous êtes Français, les gens vous parleront volontiers de foot. Les jeunes génération énuméreront tous les joueurs de l’équipe nationale de 2018 avec enthousiasme, les moins jeunes évoqueront Zidane avec émotion. Mais ici, le roi des sports n’est pas le football. Dans un pays où l’on apprend à monter à cheval avant même de savoir marcher, c’est le kok-borou qui domine – et nous avons passé bon nombre de nuits en yourte à regarder ces vidéos où, sur fond de musique épique, des chevaux se heurtent aussi violemment que leurs cavaliers.
Le Kok-Borou
Le kok-borou est un sport largement répandu en Asie Central (avec parfois quelques variations de règles et de nom). Connu depuis l’époque zoroastrienne (soit depuis plus de 2 500 ans), il est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Le concept est assez simple : deux équipes de cavaliers cherchent à s’emparer d’une carcasse de chèvre sans tête et à la lancer dans le kazan (qui signifie « chaudron » et qui est une sorte cratère) de l’adversaire. Un lancer réussi équivaut à un point.
Le jeu est brutal – et encore, il faut savoir que les règles ont été adapté au fil du temps pour le rendre plus pacifique. La carcasse pèse près de 35kg et les cavaliers n’hésitent pas à lancer leurs chevaux à pleine vitesse contre ceux de leurs adversaires pour les déséquilibrer. En ce qui concerne les but, les joueurs plongent le plus souvent dans le kazan avec la carcasse – et parfois même avec leurs chevaux. A côté, le football parait bien gentillet.
Le nom kok-borou signifie « loup gris » en kirghize. Une légende veut qu’à l’origine, ce jeu ait été joué par les nomades avec une tête de loup – tête qu’ils exposaient ensuite aux portes de leurs camps pour effrayer les meutes de loups. Au-delà d’un simple jeu, le kok-borou était une manière d’évaluer les aptitudes guerrières des joueurs et des chevaux.
Les jeux mondiaux nomades
Le kok-borou est le plus connu des jeux nomades, mais il est loin d’être le seul. En 2012, le gouvernement kirghize s’est lancé dans la valorisation de la culture nomade et de ses sports en créant les Jeux mondiaux nomades, une compétition sportive internationale consacrée aux sports d’Asie centrale. Le lieu ? Tcholpon-Ata, un plateau à plus de 2 000 mètres d’altitudes sur les rives du deuxième plus grand lac du monde, le lac Issyk-Koul (Kirghizistan). La date ? la première semaine de septembre, tous les deux ans.
La première édition, en 2014, avec un budget de 2 millions de dollars, avait ainsi rassemblé 19 pays, dont bien entendu le Kirghizistan, le Kazakhstan, la Turquie et la Russie. Au programme, une dizaine d’épreuves sportives (luttes, tirs, courses, etc.) mais aussi de dressage (fauconnerie, lévriers, etc.) et de stratégie (osselets, etc.). 250 journalistes font le déplacement pour couvrir l’événement.

La seconde édition, en 2016, pour 3 millions de dollars, a vu encore plus grand : 63 pays – dont la France ! – ont répondu présent pour 23 disciplines. C’est un succès : la cérémonie d’ouverture est vue par plus de 800 millions de personnes à travers le monde et l’événement en lui-même attire près de 60 000 de visiteurs étrangers.
La dernière édition en date, en 2018, confirme ce succès. 2 000 athlètes (contre 583 en 2014) de 77 nations sont venus disputer 36 sports, parfois très éloignés de leurs pratiques nationales, comme le tir à l’arc à dos de cheval. La compétition s’est cependant ouverte à de nombreux sports des pays alentours, comme le sumo ou le bras de fer.

Un événement culturel, économique et politique
Comme tout événement sportif, les Jeux mondiaux nomades sont hautement politiques. Pour des pays peu connus au niveau international, ils sont l’occasion de célébrer les modes de vie nomades, encore largement répandus en Asie centrale et notamment au Kirghizistan, d’attirer des touristes et de contrebalancer l’hégémonie culturelle et sportive occidentale.
A cet égard, le comité organisateur revendique trois objectifs : sportif, culturel et scientifique. Si le premier est évident, le second se concrétise dans un programme culturel très riche en marge des épreuves sportives, avec de nombreuses représentations de danse, de chants, de récits épiques (pratique très importante en Asie Centrale et sujette à concours), etc. Un ethnovillage se charge de présenter les savoir-faire locaux tels que la fabrication des yourtes, du pain plat, l’art du tapis en feutre, la nourriture locale, etc., souvent inscrits au patrimoine mondial de l’humanité. D’ailleurs, la cuisine nomade et le montage de yourte ont droit à leur propre compétition.
L’objectif scientifique passe quant à lui par un travail de documentation et d’explication des modes de vie nomades, encore peu connus à l’étranger. Plusieurs conférences et séminaires sont ainsi organisés.
Les Jeux mondiaux nomades sont également un outil économique, dans une dynamique d’essor du tourisme pour un pays qui a mis fin aux visas pour les Français en 2012 et qui a accueilli plus 1,3 millions de touristes étrangers en 2017.
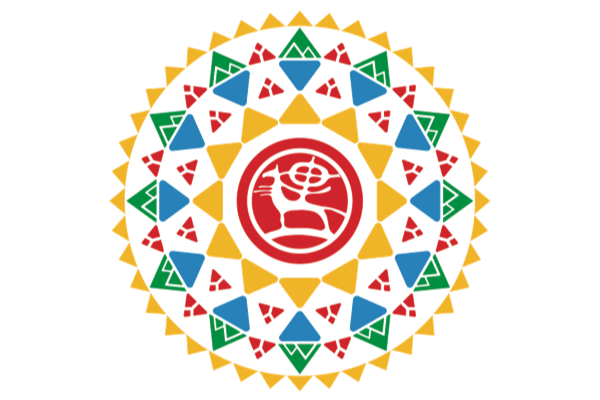
Sources :
Site officiel des Jeux mondiaux nomades de 2018 (en anglais)
Banque mondiale






































